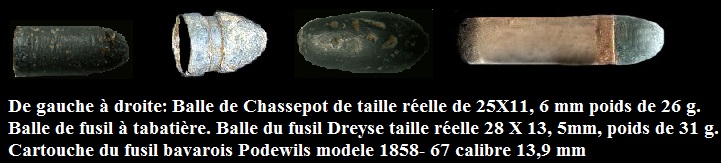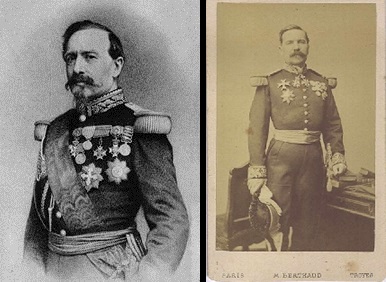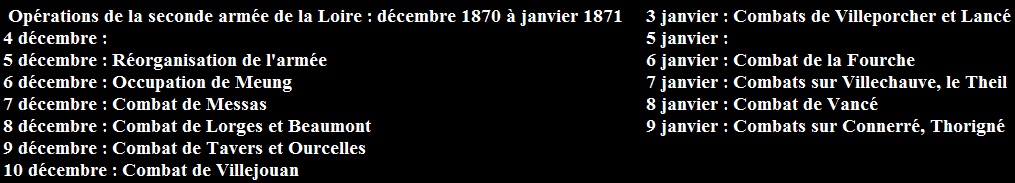CHRONOLOGIE DE LA GUERRE 1870-1871
La chronologie de la guerre franco-prussienne de 1870-71 permet d'appréhender l'histoire de cette guerre par les événements selon leur ordre temporel.
Cette chronologie s'appuie sur différents rapports, extraits du Journal officiel de la République, journaux, ouvrages bibliographiques, et de nombreux mémoires de, journal de et autres articles. Elle est succincte concernant les évènements du siège de Paris car on trouvera des explications et une chronologie complète dans l'article concernant la Chronologie du siège de Paris.
1870
Juillet
20 juillet :
Le maréchal Le Bœuf est nommé major général de l'armée du Rhin.
25 juillet :
Combat aux avant-postes de Bouzonville (Armée du Rhin)
27 juillet :
L'impératrice Eugénie est nommée régente.
28 juillet :
Napoléon III, accompagné du prince impérial, le sous-lieutenant Louis-Napoléon Bonaparte âgé de 14 ans, se rend à Metz pour prendre la tête de l'armée.
Août
2 août :
Combats de Sarrebruck, auxquels assiste le jeune prince impérial (Armée du Rhin).
4 août :
Bataille de Wissembourg dans le Bas-Rhin, première bataille qui se solde par la retraite des troupes françaises du maréchal de Mac-Mahon (division Douay) devant les troupes prussiennes du Kronprinz. (Armée du Rhin)
6 août :
Bataille de Frœschwiller-Wœrth lors de laquelle la IIIe armée allemande du Kronprinz de Prusse met en déroute les troupes françaises du Maréchal de Mac-Mahon. (Armée du Rhin)
Charges de Reichshoffen : charges vaines des cuirassiers français sur les villages de Morsbronn (où ils sont anéantis) et de Elsasshausen. (Armée du Rhin)
Bataille de Forbach-Spicheren : la division du général Frossard est écrasée, à cause de l'inaction du maréchal Bazaine (jaloux de Frossard). (Armée du Rhin)
Affaire de Rosbruck (Armée du Rhin)
8 août :
Début du siège de Bitche
9 août :
Affaire de Grostenquin (Armée du Rhin)
Combat de Boulay (Armée du Rhin)
10 août :
Début du siège de Phalsbourg
12 août :
Napoléon III, malade, laisse le maréchal Bazaine prendre la tête de l'armée.
13 août :
Affaire de Dieulouard (Armée de Metz)
14 août :
Combats indécis de l'armée du maréchal Bazaine à Borny-Colombey. (Armée de Metz)
L'Empereur quitte Metz avec le Prince Impérial en direction de Verdun
Dans les Vosges, le génie fait sauter deux ponts sur la Moselle tandis que les mobiles des Vosges marchent sur Vesoul.
Les troupes ennemies sont signalées à Vigneulles
Les correspondances télégraphiques entre Nancy et Paris sont interrompues.
15 août :
Combat de Longeville-lès-Metz (Armée de Metz)
Affaire de Mars-la-Tour (Armée de Metz)
16 août :
Début du siège de Strasbourg par l'armée prussienne.
Bataille de Rezonville en Moselle (Armée de Metz).
les restes de l'armée du maréchal de Mac-Mahon se replient sur Châlons.
Combats indécis à Gravelotte, où le Maréchal Bazaine, à la tête de deux armées aurait pu faire capituler une armée allemande isolée.
Les Allemands mettent le siège devant Toul.
16 août-14 septembre :
Siège de Toul
18 août :
Bataille de Saint-Privat, d'Amanvillers au nord-ouest de Metz, en Moselle, où les troupes du maréchal Bazaine subissent une défaite qui lui retire toute possibilité de sortir de Metz (Armée de Metz).
20 août :
Début du siège de Metz par la IIe armée prussienne.
24 août au 28 octobre :
Défense de Verdun dans la Meuse
25 août :
Ayant reconstitué une armée, le maréchal de Mac-Mahon accompagné de Napoléon III passe à l'offensive avec 120 000 soldats pour tenter de percer les troupes prussiennes et dégager le maréchal Bazaine de Metz. Il doit cependant prendre la direction de Sedan, car la route directe est barrée par les armées prussiennes.
Affaire de Passavant (Armée de Châlons)
Affaire de Sivry-sur-Ante (Armée de Châlons)
26 août :
Affaire de Lauvallières (Armée de Metz)
Combat aux avant-postes de Metz (Armée de Metz)
27 août :
Combat aux avant-postes de Metz (Armée de Metz)
Combat de Buzancy (Armée de Châlons)
29 août :
Combat de Bois-des-Dames (Armée de Châlons)
30 août :
Bataille de Beaumont un corps d'armée chargé de défendre le flanc de l'armée de Mac-Mahon est défait par l'armée du prince de Saxe. L'armée Mac-Mahon se retire sur la citadelle de Sedan.
Affaire de Poix (Armée de Châlons)
31 août :
Deux armées prussiennes, avec 240 000 hommes et 700 canons, sous les ordres des princes royaux de Prusse et de Saxe à la poursuite des troupes françaises du maréchal de Mac-Mahon, la bataille de Sedan commence (le Roi de Prusse et le Chancelier Bismarck sont présents) (Armée de Châlons).
Début de la Bataille de Bazeilles (Armée de Châlons)
Début de la bataille de Noisseville-Servigny qui durera jusqu'au 1er septembre (Armée de Metz).
Septembre
1er septembre :
Affaire de Mohon près Mézières (Armée de Châlons)
Bataille de Sedan (Armée de Châlons)
Dès le début, en observant les combats de Bazeilles (flanc est) sur une colline du village de Balan, le maréchal de Mac-Mahon est blessé, et remplacé par le Général Ducrot puis par le général Wimpffen qui invoque un ordre du gouvernement de remplacer le commandant en chef en cas de d'empêchement. Cette succession de chefs engendre un plan de bataille incohérent.
Fin de la Bataille de Bazeilles où les Marsouins de l'infanterie de marine opposent une résistance héroïque contre les troupes bavaroises.
Afin d'éviter l'encerclement de la citadelle, les chasseurs d’Afrique du général Margueritte effectuent d'héroïques mais vaines charges sur le plateau de Floing (flanc ouest).
Finalement, les troupes désorganisées se replient sur la citadelle de Sedan. Encerclées et sous le feu de l'artillerie des États Allemands qui tire sur la ville citadelle, Napoléon III fait hisser le drapeau blanc, pour éviter un massacre. Il est 16h30 la bataille est perdue. Le général de Wimpffen commande la reddition de la ville.
Fin de la bataille de Noisseville-Servigny (Armée de Metz)
Affaire de Chalampé-sur-le-Rhin (Armée de Metz)
1er septembre au 10 novembre :
Défense de Neuf-Brisach dans le Haut-Rhin
2 septembre :
L'empereur Napoléon III est fait prisonnier. Signature de l'acte de reddition par De Wimpffen et Von Molkte au Château de Bellevue situé à 2 km au sud de Sedan.
Bilan de la bataille de Sedan : 15 000 Français tués ou blessés, 91 000 prisonniers internés sur la presqu'île d'Iges bordée par la Meuse et un canal (ce lieu d'internement fut appelé "le camp de la misère"), 10 000 ont réussi à se replier sur Paris et 3 000 sont internés en Belgique ; du côté allemand, 10 000 morts ou blessés sur 250 000 hommes.
3 septembre :
Napoléon III est emmené en captivité en Allemagne (à Wilhelmshoehe, près de Kassel).
À partir du 4 septembre les troupes allemandes se dirigent vers Paris pour l'investir
5 septembre :
Affaire de la ferme de Bellecroix (Armée de Metz)
Défense de Montmédy
9 septembre :
Affaire de la citadelle de Laon
14 septembre :
Reddition de Toul
17 septembre :
Combat de Montmesly (Armée de Paris)
18 septembre :
Affaire du bois de Woippy (Armée de Metz)
Paris est désormais totalement investie
19 septembre :
Début du siège de Paris (Armée de Paris)
Reconnaissance sur Chevilly
Première bataille de Châtillon (Armée de Paris)
20 septembre :
Affaire de Bobigny (Armée de Paris)
20 septembre au 24 novembre :
Défense de Thionville en Moselle
21 septembre :
Combat du bois de Vigneulles (Armée de Metz)
22 septembre :
Affaire de Nouilly (Armée de Metz)
Combat de Colombey (Armée de Metz)
Affaire de Maison-Rouge (Armée de Metz)
Affaire de Maisons-Alfort (Armée de Paris)
23 septembre :
Combat d'avant postes au Bourget (Armée de Paris)
Combat de Villejuif (Armée de Paris)
Défense de la redoute des Hautes-Bruyères (Armée de Paris)
Combat de Pierrefitte (Armée de Paris)
Reconnaissance sur Chilleurs-aux-Bois dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Vany (Armée de Metz)
Affaire de Chieulles (Armée de Metz)
Affaire de Peltre (Armée de Metz)
24 septembre :
Engagement de Crouy-en-Thelle dans l'Oise (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
24 septembre au 14 octobre :
Défense de Soissons dans l'Aisne
25 septembre :
Affaire de Celles-sur-Plaine dans les Vosges (Armée de l'Est)
26 septembre :
Affaire de la Croix-Briquet dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
27 septembre :
Capitulation de Strasbourg.
Combat de Peltre (Armée de Metz)
Combat de Colombey-Mercy (Armée de Metz)
Affaire des Maxes (Armée de Metz)
Combat de Raon-l'Etape dans les Vosges (Armée de l'Est)
30 septembre :
Combat d'avant postes à Créteil (Armée de Paris)
Combat de Clamart (Armée de Paris)
Combat de Chevilly (Armée de Paris)
Combat de Notre-Dame-des-Mèches (Armée de Paris)
Combat du Moulin de Saquet (Armée de Paris)
Escarmouche des Alluets en Seine-et-Oise-Yvelines (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Escarmouche du bois de Vigneulles (Armée de Metz)
Escarmouche aux Maxes (Armée de Metz)
Octobre
1er octobre :
Combat aux avant-postes de Drancy (Armée de Paris)
Combat à Neuville-aux-Bois dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie).
Embuscade au lieu dit les Pins-du-Phalanstère entre Saint-Léger-en-Yvelines et Condé-sur-Vesgre. (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie).
Escarmouche de Lessy (Armée de Metz)
Affaire du Chalet Billaudel (Armée de Metz)
1er combat de Ladonchamps (Armée de Metz)
4 octobre :
Affaire d'Épernon dans l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Défense du château de Ladonchamps (Armée de Metz)
5 octobre :
Combat de Toury dans l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
6 octobre :
Combat aux avant-postes en avant de Bondy (Armée de Paris)
Combat de la Bourgonce dans les Vosges (Armée de l'Est)
7 octobre :
Bataille de Ladonchamps de Bellevue et des Trappes (Armée de Metz)
Combat aux avant-postes de Villetaneuse (Armée de Paris)
Combat aux avant-postes de Bezons : Les éclaireurs de la garde nationale de la Seine du commandant Ribeaux, les éclaireurs volontaires de la 1re division d’infanterie et 4 escadrons du 2e régiment de dragons et du 1er régiment de gendarmerie à cheval, soutenus par 4 batteries d’artillerie, s’avancent dans la plaine de Gennevilliers jusqu’aux bords de la Seine, ou ils engagent une vive fusillade avec les tirailleurs ennemis embusqués sur l’autre rive entre Bezons et Argenteuil (Armée de Paris) .
8 octobre :
Combat en avant du fort de Vanves (Armée de Paris)
Un détachement des francs-tireurs de Paris, un détachement des tirailleurs des Ternes sous les ordres du commandant Thierrard ainsi que 600 gardes mobiles des 7e bataillon de la Seine, 4e bataillon d’Ille-et-Vilaine et 1er bataillon de l’Aisne sous le commandement du général Martenot effectuent une reconnaissance sur la Malmaison en passant par Nanterre et Rueil et entrent dans le parc en effectuant une brèche.
Dans le même temps, 4 compagnies de gardes mobiles de la garnison du Mont-Valérien et les éclaireurs volontaires entrent également dans le parc par le Sud-Ouest (Armée de Paris).
Affaire de Fontaine-la-Rivière de l'Essonne (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Les Allemands incendient Chérisy (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
9 octobre :
Combat de Rambervillers dans les Vosges (Armée de l'Est)
10 octobre :
Combat d'Artenay dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat aux avant-postes de Woippy (Armée de Metz)
Défense de Civry
11 octobre :
Combats aux avant-postes de Stains (Armée de Paris)
Combat d'Orléans (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
12 octobre :
Combat de Breteuil dans l'Oise (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Défense du château de Ladonchamps (Armée de Metz)
Combat d'Épinal dans les Vosges (Armée de l'Est)
12 octobre au 18 novembre :
Défense de Montmédy dans la Meuse
13 octobre :
Deuxième bataille de Châtillon (Armée de Paris)
Combat de Bagneux (Armée de Paris)
Combats aux avant-postes de Fontenay-sous-Bois (Armée de Paris)
14 octobre :
Combat d'Ecouis dans l'Eure (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Défense de Civry
15 octobre :
Combats aux avant-postes du Raincy (Armée de Paris)
Reconnaissance près de Labaroche dans le Haut-Rhin (Armée de l'Est)
Défense de Civry
18 octobre :
Combats aux avant-postes de Bondy (Armée de Paris)
Bataille de Châteaudun dans l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
19 octobre :
Escarmouche d'Etrépagny dans l'Eure (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
21 octobre :
Première bataille de Buzenval (Armée de Paris)
Combats aux avant-postes de Champigny (Armée de Paris)
Défense du Moulin-Cachan (Armée de Paris)
Combats devant Maisons-Alfort (Armée de Paris)
Combat de Grandpuits en Seine-et-Marne (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Dreux en l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat devant Chartres en l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Luisant en l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Jouy en l'Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat aux avant-postes de Moulins-lès-Metz (Armée de Metz)
Premier combat de Cussey-sur-l'Oignon dans le Doubs (Armée de l'Est)
22 octobre :
Combat de Châtillon-le-Duc dans les Doubs (Armée de l'Est)
Combat d'Auxon-Dessus dans les Doubs (Armée de l'Est)
23 octobre :
Deuxième combat de Cussey-sur-l'Oignon dans le Doubs (Armée de l'Est)
24 octobre :
Combats aux avant-postes de Bondy (Armée de Paris)
Méprise de Dreux : Fusillade entre mobiles et francs tireurs se prenant les uns et les autres pour des Prussiens (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie).
Affaire de la forêt d'Hécourt dans l'Eure (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
25 octobre :
Combat de Binas dans le Loir-et-Cher (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Nogent-sur-Seine dans l'Aube (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
27 octobre :
Combat de Saint-Seine-sur-Vingeanne en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
Combat de Talmay en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
28 octobre :
Capitulation du maréchal Bazaine à Metz livrant à l'ennemi près de 150 000 prisonniers et un matériel considérable (Armée de Metz).
Combat de Formerie dans l'Oise (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
28 octobre-30 octobre :
Première bataille du Bourget (Armée de Paris)
29 octobre :
Affaire du Mont-Rolant, près Dole dans le Jura (Armée de l'Est)
30 octobre :
Première bataille de Dijon en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
Combats aux avant-postes de la plâtrière de Vitry (Armée de Paris)
31 octobre :
Combat d'Illiers en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Novembre
3 novembre :
Combats en avant du fort de Nogent (Armée de Paris)
5 novembre :
Combat de Germigney en Haute-Saône (Armée de l'Est)
7 novembre :
Combats de Vallière et de Saint-Laurent-des-Bois en Loir-et-Cher (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de Brethenay en Haute-Marne (Armée de l'Est)
Affaire de Provenchères en Haute-Marne (Armée de l'Est)
7 novembre au 24 janvier 1871 :
Défense de Langres en Haute-Marne (Armée de l'Est)
9 novembre :
Combat naval entre le Bouvet et le Meteor au large de La Havane.
Bataille de Coulmiers (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combats aux avant-postes d'Arcueil-Cachan (Armée de Paris)
13 novembre au 1er janvier 1871 :
Défense de Mézières en Ardennes
15 novembre :
Combats à la barricade de Vitry (Armée de Paris)
16 novembre :
Combats en avant de La Varenne-Saint-Hilaire (Armée de Paris)
17 novembre :
Combat de Tréon en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
18 novembre :
Affaire d'Illiers en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de Chevannes dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de Jaudrais en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Torçay en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de Villeneuve-sur-Yonne dans l'Yonne (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de Mantoche en Haute-Saône (Armée de l'Est)
19 novembre :
Combats au Petit-Bry (Armée de Paris)
20 novembre :
Combats au fort de Nogent (Armée de Paris)
Combat de Chagny en Saône-et-Loire (Armée de l'Est)
Affaire de Vouel, près Saint-Quentin dans l'Aisne (Armée du Nord)
21 novembre :
Affaire de Thiron-Gardais en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combats de la Fourche, de la Madeleine et de Bretoncelles14 dans l'Orne
22 novembre :
Affaire de La Ferté-Bernard dans la Sarthe (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Vougeot en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
Défense de Longwy en Meurthe
23 novembre :
Combat d'Arnay-le-Duc en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
24 novembre :
Combats aux avant-postes de Bondy (Armée de Paris)
Combats de Chilleurs, Ladon, Boiscommun, Neuville-aux-Bois et Maizières dans le Loiret15 (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Reconnaissance sur Démuin, dans la Somme (Armée du Nord)
25 novembre :
Affaire de la barricade du Pont de Sèvres (Armée de Paris)
Affaire de Broué en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de Connerré dans la Sarthe (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire d'Auxon dans l'Aube (Armée de l'Est)
Défense de La Fère dans l'Aisne (Armée du Nord)
Défense de Phalsbourg dans la Meurthe
26 novembre :
Affaire de Maulu dans l'Eure16,17 (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Lorcy dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Reconnaissance en avant de Châteaudun en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combats de Pasques, Prenois et Hauteville en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
Combat de Gentelles, dans la Somme (Armée du Nord)
Engagement de Couzon, près Langres, en Haute-Marne (Armée de l'Est)
27 novembre :
Bataille de Villers-Bretonneux également appelée bataille d'Amiens dans la Somme (Armée du Nord)
Combats de Talant, Pasques et Lantenay en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
28 novembre :
Bataille de Beaune-la-Rolande (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
29 novembre :
Combat de la Gare-aux-Bœufs (Armée de Paris)
Combat de l'Haÿ (Armée de Paris)
Affaire de Saint-Denis-le-Ferment dans l'Eure (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Affaire de La Chapelle-Onzerain dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Défense du pont de Varize en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
29 novembre-3 décembre :
Bataille de Champigny également appelée bataille de Villiers (Armée de Paris)
Nuit du 29-30 novembre :
Combat d'Etrépagny dans l'Eure (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
30 novembre :
Combat de Choisy-le-Roi (Armée de Paris)
Combat de Boiscommun dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Nuits en Côte-d'Or (Armée de l'Est)
Décembre
1er décembre :
Combats de Terminiers et de Villepion en Eure-et-Loir (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat de Bellegarde dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
Combat d'Autun en Saône-et-Loire (Armée de l'Est)
2 décembre-4 décembre :
Bataille d'Orléans dans le Loiret (Armée de la Loire et corps de troupe en Normandie)
&a
RESSOURCE MILITAIRE 1870
Troupes régulières
Régiments de ligne
Stationnés en Algérie et rappelés en France courant septembre : 429 officiers 13427 hommes
16e régiment d'infanterie
38e régiment d'infanterie
39e régiment d'infanterie
92e régiment d'infanterie
régiment étranger
trois bataillons d'infanterie légère d'Afrique
trois compagnies disciplinaires
Cavalerie
Division Reyau : provenant du 13e corps, envoyée à Orléans le 15 septembre
200 officiers, 2300 hommes, 2700 chevaux
9e cuirassiers
6e dragons
2e lanciers
5e lanciers
11e chasseurs
5e hussards
Détachements de spahis venus d'Algérie
Artillerie
1500 hommes, 1800 chevaux
sept batteries en reformation à Lyon, Valence te Grenoble
cinq batteries stationnés en Algérie : 54 officiers, 1807 hommes, 572 chevaux
Génie
stationnés en Algérie : 18 officiers, 653 hommes
Troupes régulières de dépot
2373 officiers, 145333 hommes
Infanterie
1274 officiers, 100472 hommes
91 depôts de régiments, 14 de bataillons de chasseurs, 3 de zouaves, 3 de tirailleurs
Cavalerie
772 officiers, 27237 hommes, 13359 chevaux
9 depôts de cuirassiers, 11 de dragons, 8 de lanciers, 9 de chasseurs, 7 de hussards, 4 de chasseurs d'afrique
Génie
39 officiers, 2012 hommes
2 depôts
Train des équipages
37 officiers, 4976 hommes, 4383 chevaux
2 depôts
Ambulances
198 médecins militaires, 39 en France, 159 en Algérie
Troupes opérationnelles
Hommes ayant reçu une instruction militaire Hommes sans instruction militaire Total
Infanterie : 14827 85645 100472
Cavalerie : 20488 6769 27257
Artillerie : 10306 5286 15592
Génie : 1805 207 2012
Total : 47426 97907 145333
Bilan global
Armée régulière en France et Algérie : 180000 hommes
Garde nationale mobile : 225000 hommes
Classe 1869 incorporée dans la garde nationale mobile : 140000 hommes
Classe 1870 : 160000 hommes
Corps francs : 30000 hommes
Hommes de 25 à 35 ans (loi du 10 août) : 170000 hommes
Classes 1865 et 1866 (loi du 13 août) : 10000 hommes
Total : 915000 hommes
L'ARMÉE DE L'EST
Armée de l'Est
L'Armée de l'Est fut la dénomination officielle d'une armée française lors de la guerre franco-prussienne de 1870.
Création : décembre 1870
Dissolution : 1er février 1871 désarmement et exil en Suisse.
Pays : France
Branche : Armée de Terre
Guerres : Guerre franco-allemande de 1870 Bataille de Villersexel, Bataille d'Héricourt (1871), retraite vers la Suisse.
Commandants
Général Bourbaki Général Clinchant
1816-1897 1820-1881
Elle prend naissance en décembre 1870 à Bourges, à partir de la division de l'armée de la Loire et s'étoffe tant bien que mal durant son parcours en direction du nord-est (Chalon-sur-Saône, Besançon). Elle a pour objectif de couper les arrières et les lignes de communication des Prussiens, et au passage, de délivrer Belfort, où le Colonel Denfert-Rochereau s'est enfermé avec ses troupes dans la citadelle. Après avoir débarqué le gros de ses troupes à la gare de Clerval (petite ville au nord de Besançon), le général Charles Denis Bourbaki engage sa campagne à l'Est. Première étape : s'emparer de Villersexel (Haute-Saône).
Composition
15e corps d'armée
18e corps d'armée
20e corps d'armée
24e corps d'armée
Réserve générale
Batailles
Le 8 janvier 1871, la bataille de Villersexel est engagée. Le lendemain, elle connait son apogée par une victoire des troupes françaises. Sous le commandement de l'intuitif général August von Werder, les Prussiens se retirent de Villersexel (car pour Werder, cette ville n'a rien de stratégique), et migrent en direction de Montbéliard. Les Prussiens s'installent alors sur une ligne géographique qui suit un petit cours d'eau : la Lizaine. Au sud, Montbéliard et Héricourt, au nord, Frahier. Les troupes prussiennes rejoignent ainsi les contingents qui occupent déjà tout le Pays. Werder suppute (à raison) le plan de Bourbaki qui est de se diriger sur Belfort afin de reprendre la ville et délivrer la garnison française.
Mais enlisée à Villersexel dans des problèmes d'organisation et de ravitaillement de toutes sortes, l'armée de l'Est est incapable de poursuivre rapidement son adversaire. Mettant ainsi à profit cette inaction, les troupes prussiennes prennent pied sur la rive gauche de la Lizaine. Cette rivière, bien que peu importante, forme un obstacle naturel. De plus, le remblai de la ligne de chemin de fer qui suit la Lizaine (de Montbéliard à Héricourt) offre un abri inopiné pour les Prussiens. Les Prussiens profitent de deux jours de répit (10 et 12 janvier) pour placer des soldats tout le long de la Lizaine. Des bouches à feu sont installées sur les hauteurs : à Chalonvillars (pour défendre Chenebier et Frahier), au Mont-Vaudois (pour tenir Héricourt) et à Montbéliard (aux mains des Prussiens depuis novembre 1870), au niveau des Grands-Bois et sur ce qu’on appellera plus tard les Batteries du Parc. Les soldats allemands profitent de la valeur défensive de la Lizaine dont la largeur oscille entre 6 et 8 mètres et la profondeur près d’un mètre. Ils font sauter la plupart des ponts, bourrent d’explosifs les autres, aménagent les routes pour faire passer le ravitaillement. Les Français, de leur côté, sont sur un terrain boisé difficile. Ainsi donc, de Montbéliard à Frahier, une ligne de front d'environ 20 km est puissamment défendue.
Le 14 janvier, les premiers contingents français parviennent dans la région d'Arcey (à 10 km au sud-est de Montbéliard). Après quelques escarmouches avec des postes avancés prussiens, l'armée de l'Est parvient sur les hauteurs de Montbéliard. Le plan de Bourbaki consiste en une attaque frontale déployée sur 19 km.
Composée de 140 000 hommes, l'armée est hétéroclite et improvisée. L'ennemi est composé d'environ 52 000 hommes. Le climat en ce début de bataille est extrêmement rigoureux. Il neige, et il a neigé abondamment durant les jours précédents ; la température nocturne atteint -20°C. Alors que les Prussiens ont trouvé des abris par réquisitions, les troupes françaises bivouaquent dans les bois et dans les chemins creux. En dépit des actes de bravoure accomplis dans la région de Villersexel, c'est une armée épuisée et mal équipée qui arrive pour combattre sur le front de la Lizaine (par exemple, on manque totalement de fers à glace pour les chevaux). Les premiers combats s'engagent devant les villes d'Héricourt et de Montbéliard. Les troupes pénètrent dans Montbéliard et attaquent le château pour y déloger les Prussiens qui tirent à l'arme lourde. Le petit village de Bethoncourt au nord-est de Montbéliard connait un douloureux combat durant lequel succombent des bataillons de savoyards et de zouaves. Mais les luttes les plus sanglantes se déroulent devant Héricourt et Chagey. Pendant trois jours, les combats sur la ligne de la Lizaine connaissent des affrontements acharnés.
Retraite
Le 18 janvier, aucune percée décisive n'ayant été marquée, le général Bourbaki décide de suspendre les combats et d'opérer la retraite de ses troupes en direction du sud, vers Besançon. La libération de Belfort aura donc échoué. Mais prise en tenaille par une nouvelle armée (Manteuffel), l'Armée de l'Est est contrainte de dévier sa marche en direction de Pontarlier. Cette retraite sur le plateau du Haut-Doubs, dans le froid sévère et la neige, est comparable au tableau du radeau de la Méduse. Les soldats, affamés, épuisés, décimés par le froid, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Par une négligence des négociateurs, l'armée de l'Est n'est pas comprise dans les conditions de l'armistice franco-allemand signé le 28 janvier 1871. Acculée à la frontière suisse, l'Armée de l'Est est prise au piège. Bourbaki tente alors de se suicider. Il laisse le commandement de l'Armée au général Justin Clinchant, son principal adjoint. Ce dernier négocie la Convention des Verrières avec le général suisse Hans Herzog qui prévoit l'internement de son Armée en Suisse, après qu'elle eut été désarmée au passage de la frontière. À partir du 1er février, 87 847 hommes dont 2 467 officiers commencent à passer la frontière, principalement aux Verrières.
L'Armée de l'Est dans l'art et la littérature
Cette tragédie a été immortalisée sous la forme d'un panorama circulaire exceptionnel réalisé par le peintre suisse, Edouard Castres, et ses collaborateurs, que l'on peut voir à Lucerne (Suisse). Le panorama circulaire Bourbaki se présente sous le forme d'une rotonde d'un diamètre de plus de 40 m. Il existe peu de panoramas de ce genre dans le monde. Réalisé sur la base de nombreuses esquisses dessinées pendant cette guerre, il est le témoignage historique d'une qualité documentaire exceptionnelle. Cette œuvre constitue un document à la mémoire de la première grande action humanitaire de la Croix-Rouge suisse, et de la politique de neutralité de la Confédération. Le thème très particulier on peut même dire unique du panorama est l'incommensurable misère des soldats blessés, affamés et gelés qui ont passé la frontière suisse le 1er février 1871. Après avoir réalisé un grand nombre de projets, le peintre Castres a ainsi associé à l'idée de guerre, non pas la notion de victoire, mais la notion de douleur. Le cadre choisi : un triste paysage d'hiver gris-blanc, d'immenses champs couverts de neige, a permis d'accentuer la tragédie humaine soigneusement décrite. C'est en colonnes interminables que les soldats traversent le champ de vision des visiteurs.
L'ARMÉE DE LA LOIRE
Début octobre, le 15e corps sous les ordres du général La Motte-Rouge, s'avance au nord d'Orléans.
Le général Von der Tann est désigné pour l'arrêter. Il a sous ses ordres trois divisions de cavalerie, la 22e division prussienne et le 1er corps Bavarois.
9 octobre : Arrivée de Gambetta à Tours.
Il prend le ministère de la guerre et commence la formation d'une armée nouvelle.
Il organise la levée en masse et fait afficher une proclamation de mobilisation générale.
10 octobre : L'avant-garde française est battue à Artenay et se replie dans la forêt d'Orléans.
(Engagement allemand : 14000 hommes et 100 canons, pertes : 200 hommes.
Engagement français : 8000 hommes et 16 canons, pertes : 900 hommes tués, blessés ou prisonniers).
Après une importante résistance, les troupes françaises battent en retraite sur Orléans.
13 octobre : Orléans est occupé par les prussiens.
13 octobre : constitution de la 1e armée de la Loire :
Création de la 1e armée de la loire constituée des 15e et 16e corps sous les ordres du général d'Aurelle de paladines.
18 octobre : A Châteaudun, 900 francs-tireurs (Cdt Lipowski) et 300 gardes nationaux défendent la ville sous le feu de 2000 obus. La résistance dura toute la nuit.
Châteaudun fut occupé et totalement incendié par les prussiens.
8 novembre : Orléans est évacué devant l'approche des troupes de l'armée de la Loire.
9 novembre : Victoire de Coulmiers. (Engagement allemand : 22000 hommes. Engagement français : 65000 hommes).
Le grand-duc de Mecklembourg doit faire face aux troupes françaises.
L'état-major prussien prend conscience de la menace de l'armée de la Loire.
Le prince Frédéric-Charles est appelé en renfort.
Le 17e, 18e et le 20e corps viennent compléter l'armée de la Loire.
Le général d'Aurelle de Paladines choisit de rééquiper son armée, et fortifier ses positions sur Orléans en vue d'une attaque ennemie.
Mais le gouvernement souhaite un mouvement vers Paris assiégé.
Le 24 novembre : sur ordre du gouvernement de Tours, les 15e, 18e et 20e corps font mouvement sur Pithiviers.
30000hommes (20e corps et une partie du 18e), commandés par le général Crouzat, se heurtent au Xe corps prussien qui remporte
une victoire difficile à Beaune-la-Rolande le 28 novembre.
(pertes françaises : 3000 hommes et 1600 prisonniers, pertes allemandes : 900 hommes et une centaine de prisonniers).
Début décembre, Freycinet, délégué à la guerre, décide une nouvelle offensive.
Les 16e et 17e corps se brisent à Loigny le 2 décembre devant l'armée du Grand Duc de Mecklembourg.
Les prussiens ont l'avantage et décident une offensive générale sur Orléans les 3 et 4 décembre.
Orléans est à nouveau occupé. (pertes françaises : 20000 hommes dont 2000 tués ou blessés, pertes allemandes : 1800 hommes).
Le prince Frédéric-Charles et le général de Moltke considèrent que l'armée de la Loire est anéantie et que la guerre touche à sa fin.
À Paris, le général Trochu ne désespère pas et garde l'espoir d'une libération de la capitale.
Peu inquiet d'une éventuelle résistance des troupes françaises, Frédéric-Charles scinde son armée de façon à couvrir simultanément plusieurs directions.
5 décembre : constitution de la 2e armée de la Loire :
Gambetta réorganise les armées; d'Aurelle est écarté. Les 15e, 18e et 20e corps sont confiés à Bourbaki sous l'appellation d'Armée de l'Est; les 16e, 17e et 21e corps à Chanzy sous l'appellation de 2e armée de la Loire.
Le 7 décembre : La 2e armée de la Loire arrête les troupes du grand-duc de Mecklembourg.
Une offensive menée le 8 décembre menace les prussiens qui parviennent difficilement à maintenir leurs positions.
Les 14 et 15 décembre : combats de Fréteval et Vendôme.
Frédéric-Charles envoie le Xe corps au secours de l'armée du grand-duc, et fait revenir le IIIe corps à Orléans.
Des jours durant, l'armée française composée en majorité de mobiles et volontaires, résiste aux efforts de l'ennemi.
C'est une retraite lente, marquée chaque jour par des affrontements sérieux. Les conditions climatiques sont éprouvantes avec le froid et la neige.
La tenacité de Chanzy et la motivation de ses troupes va surprendre les prussiens qui avoueront plus tard leur admiration.
Le 21 décembre: replié au Mans, le général Chanzy envoie des colonnes mobiles dont la mission est de reconnaitre les régions abandonnées
Chaque jour est marqué par des affrontements sur Tours, Vendôme, Nogent, Châteaudun.
L'armée de Bourbaki s'étant dirigée vers l'Est, Frédéric-Charles rassemble toutes ses troupes contre l'armée de la Loire.
Les IIIe, IXe et Xe corps prussiens trouvent une victoire laborieuse lors de la bataille du Mans (10 et 11 janvier) face à des combattants français épuisés.
La retraite est organisée pour un repli en ordre sur la Mayenne.
Le 16 janvier : l'armée de la Loire est à Laval et occupe une ligne de défense sur la rive droite de la Mayenne.
Chanzy réorganise ses troupes pour une reprise des hostilités alors qu'un armistice de 21 jours est signé le 28 janvier.
Paris n'est plus l'objectif de l'armée de la Loire. Chanzy prépare un mouvement vers le bassin de la Vienne pour couvrir Bordeaux et le Midi de la France.
14 mars : dissolution de l'armée de la Loire suite à l'armistice définitif.
Paris Loire Est Nord
4 sept. Fin de l’empire, proclamation de
La République
18 sept. Début de l’encerclement de Paris
28 sept. Reddition de Strasbourg
7 octobre Gambetta quitte Paris Gambetta quitte Paris pour Tours
10 octobre À Tours, Gambetta décide un appel
À la levée en masse.
Bataille d’Artenay
11 octobre Occupation d’Orléans
27 octobre Capitulation de Metz
28 octobre Combat du Bourget
4 novembre Siège de Belfort
9 novembre Combat de Coulmiers
18 novembre Création de l’Armée du Nord
commandée par Faidherbe
28 novembre Bataille de Beaune la Rolande
30 novembre Sortie de Champigny
2 décembre Occupation d’Orléans Constitution de l’Armée de
4 décembre Constitution de la 2e Armée de la l’Est (Bourbaki
Loire (Chanzy)
7 au 10
décembre Bataille de Beaugency
8 et 9
Décembre Reprise d’Amien
23 décembre Bataille de Pont-Noyelles
3 janvier Bataille de Bapaume
5 janvier Début du bombardement
9 janvier Bataille de Villersexel
10 et 11
Janvier Bataille du Mans
15 au 17
Janvier Bataille d’Héricourt
19 janvier Combat de Buzenval Bataille de ST-Quentin
27 janvier Capitulation de Longwy
28 janvier Reddition de Paris
Signature de l’armistice
8 février Élection de l’assemblée national
17 février Adolphe Thiers, chef du gouvernement
18 février Reddition de Belfort
1er mars Entrée des prussiens à Paris
10 mai Traté de Francfort
Opération de l'armée de la Loire